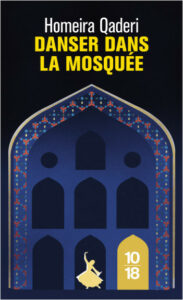La création artistique comme un cri et un appel à la solidarité avec l’Afghanistan
Un thé vert en hommage à la résistance culturelle franco-afghane, par Régis Koetschet
Cet article est extrait du N°183 des Nouvelles d’Afghanistan
« La terre tremble. Près de nous – « la folie des hommes gronde » et le sang coule – près de nous, car on ne peut plus penser les frontières comme au siècle dernier. Nous sommes touchés. Un temps s’arrête puis il y a un vertige et un silence latent fort. La douleur impose un repli. Quand le corps a mal à un endroit, toute la concentration de notre esprit est focalisée par cette douleur, le corps perd l’équilibre. L’horizon seul invite au mouvement. La création artistique ouvre des horizons. Partager ensemble des œuvres aide à rendre supportable le silence et mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons ensemble ». C’est par ces mots que Guilda Chahverdi a, le 13 octobre, ouvert le vernissage de l’exposition Afghanistan, Tisser l’horizon à l’infini présentée à la chapelle du Méjan d’Arles. À proximité d’une mer Méditerranée, la mare nostrum de Fernand Braudel, dont les flots baignent les côtes d’Israël et de la Bande de Gaza.
L’action politique à l’égard de l’Afghanistan paraît figée. L’ampleur des drames que connaît le monde, du Proche Orient à l’Ukraine, mobilise les diplomaties au risque de voir les souffrances du peuple afghan perdre en priorité pour relever de crises silencieuses sinon oubliées au regard d’une actualité carnivore toujours plus « immédiate ».
Les acteurs culturels s’élèvent contre cet effacement. Ils le font avec force et talent. En cet automne, en « terre d’inquiétude », pour citer André Malraux dans L’Expédition d’Ispahan, un tour de l’Hexagone – avec un crochet par Lomé, capitale du Togo (voir encadré)– en témoigne brillamment.
Les images de Noroozi, témoins d’une résilience
Dans le cadre du 35ème Festival Visa pour l’image de Perpignan, le prix du Visa d’or Magazine a été décerné, le 9 septembre, au photographe iranien Ebrahim Noroozi pour une série de photos intitulée Le pays le plus triste au monde et le pire pays pour les femmes. Né en 1980 à Téhéran et photo- reporter à l’agence Associated Press (AP) depuis 2013, il séjourne actuellement en Afghanistan. Il avait déjà réalisé une série sur les Afghanes privées de sport. Ebrahim Noroozi a présenté son travail en termes clairs et vigoureux : « En Afghanistan, les talibans sont au pouvoir depuis maintenant deux ans et les Afghans sont plongés dans une misère toujours plus profonde. J’ai cherché à dépeindre le visage humain de ce désespoir en montrant comment les gens s’efforcent de résister alors que l’économie s’effondre autour d’eux, que les talibans imposent toujours plus de restrictions et effacent les femmes de la société.
Pour cela, je me suis rendu dans les briqueteries où des familles ont été contraintes de faire travailler leurs propres enfants. Les petits garçons et les petites filles, sombres mais résignés face à leur devoir, effectuent des travaux pénibles, façonnant, cuisant et transportant des briques d’argile. Une récente enquête de Save the Children estime que, dans un foyer afghan sur deux, les enfants doivent travailler juste pour que la famille puisse manger. (…) L’inflation et le chômage se sont envolés et les Afghans n’ont plus les moyens de se nourrir. Selon le PAM, la moitié de la population est dans une situation de faim aigüe, et six millions de personnes sont au bord de la famine.
J’ai marché sous les ponts et dans les montagnes de Kaboul, où j’ai vu de plus en plus de toxicomanes se tourner vers le méthamphétamine et l’opium pour échapper à la dure réalité du quotidien. J’ai rencontré des jeunes femmes qui s’épanouissaient avant dans le sport, mais qui n’ont plus le droit aujourd’hui de pratiquer les activités qu’elles aiment.
Elles ont l’impression que leur avenir est brisé. « Je ne suis plus la même personne », a confié une jeune femme qui pratiquait la boxe. « Depuis que les talibans sont arrivés, j’ai l’impression de ne plus exister ».
Les Afghans semblent avoir perdu tout espoir. Le sondage annuel Gallup, qui évalue les émotions dans les pays du monde entier, a mis en lumière une partie de la misère de l’Afghanistan à travers des chiffres, notant que depuis le retour des talibans, le pays a le plus faible niveau d’émotions positives de tous les pays étudiés au cours des seize dernières années. Un Afghan sur quatre a évalué sa vie à zéro et près de quatre sur dix ont déclaré s’attendre à être à zéro d’ici cinq ans. 98 % ont si mal noté leur vie qu’ils ont été classés dans la catégorie « en souffrances ». Pour les femmes, les restrictions sont telles que l’on peut parler d’une véritable invisibilisation ».
Sur cette réalité désespérante, les images de Noroozi, d’une très grande maîtrise technique, exposent la froide absurdité du pouvoir mais elles s’attachent surtout, avec beaucoup d’humanité, à témoigner de la résilience digne des plus faibles.
Danser dans la mosquée
Le 26 septembre, l’association Lorientale, basée à Lorient et qui a pour objectif de « faire connaître l’Orient et ses valeurs culturelles », a décerné son prix littéraire à l’écrivaine afghane Homeira Qaderi pour son livre Danser dans la mosquée – Lettre d’une mère afghane à son fils. Paru chez Julliard en 2022, ce récit poignant et magnifique vient de faire l’objet d’une édition de poche chez 10/18 avec une superbe couverture. Homeira Qaderi, née en 1980 à Kaboul, a grandi à Hérat et connu jeune les rigueurs de l’exil en Iran, pays qui pour autant lui a permis de se former à l’écriture et d’y publier ses premiers textes. Très engagée pour l’égalité des droits des femmes, elle a durant la décennie qui précède le retour des tâlebân enseigné à Kaboul dans des universités privées, travaillé comme conseillère au ministère des Affaires sociales puis à celui de l’Éducation nationale et participé aux grandes conférences internationales relatives à l’Afghanistan. Elle vit désormais en Californie. Danser dans la mosquée est son autobiographie. On y suit la vie d’une petite fille afghane, enjouée, curieuse et qui n’a pas froid aux yeux au sein d’une famille simple, aimante et protectrice, puis d’une adolescente dans ses désirs et ses révoltes, enfin d’une jeune mère qui du fait d’une polygamie non acceptée sera privée de son enfant. C’est à lui, Siawash, qu’elle s’adresse. Un parcours de vie confrontée à l’histoire violente et répressive de l’Afghanistan, notamment durant le régime tâlebân, et aux pesanteurs et hypocrisies d’une société comme égarée entre ses traditions et ses espoirs de progrès. Un parcours de combat entrecoupé de moments de grâce et de beauté comme une « danse dans une mosquée ».
« Je t’aime, Siawash, mais si c’était à refaire, je ne changerais rien, j’attendrais d’être assez âgée et établie pour avoir un enfant. Je n’ai jamais voulu me définir exclusivement comme mère. J’ai toujours considéré mes livres comme mes bébés – mes filles, dont chacune symbolisait l’émancipation des femmes ». Ce livre est un bijou, un diamant aux multiples facettes, brillant et dur, tranchant et éclatant.
Tisser un horizon
Françoise Nyssen nous a accueillis, le 13 octobre, à Arles, à la chapelle Méjan – l’espace culturel d’Actes Sud – avec beaucoup d’émotion. Ce programme sur l’Afghanistan avait été initié par son mari, Jean-Paul Capitani, peu de temps avant sa disparition accidentelle. La rencontre s’était nouée avec Zolaykha Sherzad, en marge de la présentation de son travail textile avec les femmes afghanes, au musée Guimet dans le cadre de l’exposition sur le centenaire de la DAFA (octobre 2022-février 2023).
Tisser l’horizon à l’infini – nom donné au projet arlésien – apparaît comme le confluent de l’expérience unanimement saluée de Guimet et de Kharmora – l’Afghanistan au risque de l’art qui avait rassemblé le travail d’artistes afghans au MUCEM de Marseille (novembre 2019-mars 2020). C’est dire la grande richesse de cette démarche artistique à laquelle la chapelle Méjan offre un espace somptueux, vaste et adapté, qui permet toutes les perspectives, entre fluidités et intimités.
Ces « regards croisés » rassemblent dans une symphonie affectueuse, douloureuse et respectueuse les œuvres (création textile, photographie, peinture, installation, film) de deux artistes français (Pascal Convert et Ferrante Ferranti) et de six artistes afghans (Latif Eshraq, Morteza Herati, Zahra Khodadadi, Zolaykha Sherzad, Mohsin Taasha, Naseer Turkmani). S’y ajoutent les traces visuelles fortement émouvantes de deux grands témoins de l’Histoire, Ria Hackin et Marc Riboud.
Le corps, intime et revendiqué, brisé et renaissant, est le fil conducteur de cette traversée afghane, des ruelles d’Hérat aux neiges du Koh-e Baba. « Les artistes expriment son absence, les empreintes de la cruauté qui le marque, l’amour dont il est le témoin, le deuil qui dilue le temps et l’horizon, source d’espoir et d’élévation » nous dit Guilda Chahverdi, commissaire de l’exposition. Dans l’espace inspirant de Méjean, merveilleusement mis en scène, les œuvres et tout particulièrement les pièces splendides de Zolaykha Sherzad, préparées par le travail infini des brodeuses, se tendent, s’enrobent, se drapent, s’envolent vers un « infini » qui nous emporte.
Bartabas
Le spectacle équestre Zingaro, intitulé Femmes persanes, a débuté le 20 octobre au Fort d’Aubervilliers, au nord de Paris. C’est le troisième volet de la série Cabaret de l’exil après la culture yiddish et les nomades irlandais. Bartabas rend, cette fois, hommage à l’esprit de résistance des femmes iraniennes et afghanes. Des artistes exilées venant de ces deux pays interviennent dans ce spectacle magique, d’une grande beauté – et que l’on regarde avec émotion.
Bartabas aime les nomades et les chevaux sauvages de la Bactriane. Il les a déjà célébrés et sa complicité avec le poète André Velter, amoureux fou de l’Afghanistan, et l’artiste Ernest Pignon-Ernest a conduit à la publication du livre Zingaro suite équestre et autres poèmes pour Bartabas (Gallimard 2012). On citera pour le plaisir ce poème de Velter : « Et les chevaux, les chevaux surtout, conquièrent un espace inédit, inouï, chimérique et plus vaste. Comme le ferait un djinn de Haute-Asie, un peintre chinois ou un chaman mongol, Bartabas leur invente des prairies de nuage, des carrières de fumée, des ravins de grand vent. Il leur offre des lisières sans clôture, des no man’s land de feu, et un accès direct au royaumes des légendes ».
Femmes persanes porte cette même sensibilité. Les acrobaties équestres s’articulent avec les landay, les danses avec les crinières, les paons avec la caravane qui passe, les ânes avec les turbans. On « rit avec Dieu » comme aurait dit Bahoudine Majrouh (mentionné dans le catalogue) dans un spectacle complet – telle une miniature de Behzad.
De cette cavalcade à la poésie, à moins que ce ne soit l’inverse, les cavalières afghanes et leurs sœurs iraniennes, en funambules, s’élèvent au-dessus des ténèbres, farouches et indomptables, telle leur monture. « Je suis moi, je suis femme, je suis monde, je chante la liberté, je chante la tendresse ! » (poème écrit sur un chant patriotique par les Afghanes Sedâ Soltani et Zahrâ Moussavi sous le titre Me voici ! Je suis femme !).
Ce relevé est certainement incomplet et l’on grappillera au passage la tenue, le 7 octobre à Paris, d’un salon du livre afghan organisé par l’association Nayestane, l’inspirante exposition de photographies de Jean-Charles Blanc à Pont-Croix, à proximité de la pointe du Raz, en hommage et avec le simple titre Afghanes, ouverte le 20 octobre ainsi que la présentation au théâtre Thénardier de Montreuil, le 18 novembre, du spectacle des marionnettistes Abdulhaq Haqjoo et Farhad Yaqubi Marjan le dernier lion d’Afghanistan sur un texte de Guilda Chahverdi et une mise en scène de Mélanie Depuiset.
Toutes ces manifestations culturelles de haut niveau sont autant de regards croisés et solidaires, fidèles, frottés aux duretés de l’exil. Ils justifient pleinement notre souhait que la commémoration du « centenaire » des relations d’amitié entre la France et l’Afghanistan se poursuive comme la marque d’une exigence.
D’Arles à Kaboul, d’Aubervilliers à Hérat, les métiers, les formes artistiques et les générations se rencontrent dans un élan de créativité pour tisser un horizon de liberté que l’on souhaite le plus proche possible.
Régis Koetschet
Les Hirondelles de Kaboul à Lomé
Les Hirondelles de Kaboul se sont posées à Lomé et ont aboli, le temps d’une représentation, les frontières spatiales et temporelles. Au moment où le monde a les yeux rivés vers cet « Orient compliqué » reléguant les crises au Sahel à l’arrière-plan de la tragédie, l’actualité internationale revient par une porte dérobée -celle du théâtre- à Lomé avec la production du chorégraphe et metteur en scène béninois Sèdjro Giovanni Houansou. Ainsi se retrouvent sur la scène de l’Institut français du Togo Atiq, le moudjahid reconverti en geôlier, Mohsen qui rêvait de modernité et son épouse Zunaira. Le texte de Yasmina Khadra déploie sa force et trouve son public, touché par les histoires singulières et universelles d’Atiq, de Mohsen et des autres. Certes Tombouctou n’est pas loin mais la force de « l’évidence » du texte de Yasmina Khadra sur ces terres africaines, comme aime à le rappeler Sèdjro Houansou, repose moins sur les références à l’islam ou la résistance des sociétés traditionnelles que sur la reconnaissance que tout continent est le réceptacle lui aussi de l’Histoire, et sinon d’un clash des civilisations, au moins de l’affirmation violente des identités dans la mondialisation. Non, Les Hirondelles de Kaboul n’est pas une tragédie venue d’ailleurs. C’est la nôtre.
Augustin FAVEREAU
Ambassadeur de France à Lomé